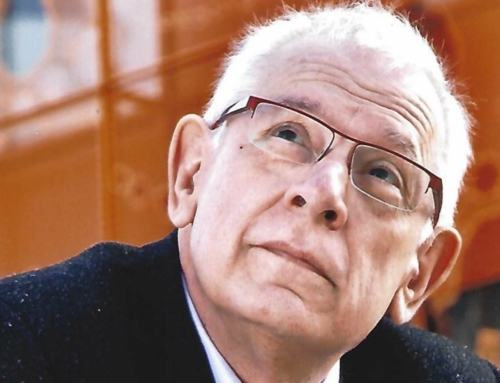En France notamment, le long déploiement de la massification scolaire, de l’ouverture du lycée à celle de l’enseignement supérieur, a renforcé « l’emprise scolaire » : le rôle décisif du diplôme dans l’accès à l’emploi, aux revenus et à la qualité du travail. Il est a priori évident que le tri des individus par les diplômes et le mérite scolaire est moins injuste et plus efficace que l’héritage familial des destins sociaux [1]. Cependant, l’emprise scolaire a engendré des effets paradoxaux ou contre-intuitifs qu’il n’est pas possible d’ignorer. Nous en soulignerons deux.
La préférence pour l’inégalité
Le premier de ces effets est une préférence pour l’inégalité. Quand chacun sait que le niveau scolaire des enfants détermine leur avenir social et professionnel, les parents ont intérêt à choisir les formations scolaires les plus efficaces, les plus rentables et les plus distinctives. Les familles qui le peuvent se mobilisent pour développer l’éducation la plus efficace pour choisir le meilleur établissement, la meilleure filière, les disciplines les plus rentables… Et ces choix sont de plus en plus précoces.
Les familles les plus compétentes et les plus fortunées accroissent leurs avantages et, à terme, la reproduction des inégalités reste ce qu’elle était. Si l’accès au baccalauréat et à l’enseignement supérieur s’est considérablement élargi, ce qui est une bonne chose, les inégalités au sein du système de formation se sont maintenues, voire renforcées malgré les dispositifs a priori favorables à l’égalité des chances. Aux deux extrémités du système social, les riches et les pauvres ne fréquentent plus la même école, comme le montrent les indices de position sociale (IPS) [2] des établissements et le succès de l’école privée.
Bien que ce constat puisse sembler scandaleux en regard des valeurs et des promesses de l’école républicaine, le jugement moral n’est pas de mise. En effet, comment en serait-il autrement quand les parcours scolaires ont remplacé les destins sociaux fixés par la naissance et quand chaque famille, y compris les moins favorisées, veut ce qu’il y a de mieux pour ses enfants, quand chacun sait que tout se joue à l’école ? De manière globale, nous avions constaté que plus l’emprise des diplômes est élevée, plus les inégalités scolaires sont fortes [3]. Le monopole de l’école dans la définition du mérite accentue « mécaniquement » les inégalités scolaires et leur reproduction.
Vainqueurs, vaincus et populismes
Ayant le quasi-monopole de la définition du mérite et du tri des individus, l’école instaure un clivage entre les vainqueurs et les vaincus de la compétition scolaire, et ce clivage est d’autant plus cruel que le mérite académique semble toujours plus puissant et plus légitime que le mérite professionnel. Ce clivage a de lourds effets politiques.
À l’aube du grand mouvement de massification scolaire, il semblait aller de soi que l’élévation du niveau scolaire de tous forgerait des citoyens adhérant plus fortement aux valeurs de la démocratie : la confiance dans les institutions et dans la science, la tolérance, l’ouverture au monde… De manière générale, l’adhésion déclarée à ces valeurs a progressé et les plus diplômés y sont plus attachés que les autres. Mais au même moment, force est de constater, en France et ailleurs, que les partis populistes triomphent, que les demandes autoritaires s’accroissent, que le rapport à la vérité s’affaiblit et que rien n’est plus spectaculaire que le basculement trumpiste de la société américaine. Comment expliquer ce paradoxe ?
Pour le dire de manière très grossière, jusqu’aux années 1980, les travailleurs peu ou pas diplômés votaient majoritairement à gauche pendant que la population diplômée était, plus globalement, conservatrice. Depuis, ce clivage a basculé et le diplôme joue un rôle décisif dans le choix électoral. Les moins diplômés ne votent pas ou votent de plus en plus pour les partis populistes de droite, pendant que les plus diplômés votent plutôt pour les partis libéraux, la gauche et les Verts.
Ce basculement, fort inquiétant pour l’avenir des démocraties, repose pour partie sur la xénophobie de certains électeurs, ainsi que la situation économique et sociale (bas salaires, précarité élevée notamment). On oublie trop souvent qu’il a aussi pour fondement l’emprise des diplômes elle-même. Plus précisément, il est la conséquence du monopole scolaire de la définition du mérite des individus. En effet, au nom de l’idéal méritocratique, les vainqueurs de la compétition scolaire ne devraient leur succès qu’à eux-mêmes et il n’est pas rare que leur « arrogance » leur soit reprochée. Et au nom de ce même idéal, les vaincus, déclassés, sont tenus pour responsables de leurs échecs. Dès lors, ils se sentent légitimement humiliés et se retournent contre les valeurs mêmes de l’école qui sanctionnent leur absence de mérite : ils en veulent aux « sachants », aux experts, aux donneurs de leçons, à tout ce qui fonde la domination sociale sur le mérite académique. Encore une fois, le trumpisme est la caricature de cette attitude, mais n’imaginons pas qu’elle reste circonscrite aux États-Unis.
Tout doit être fait pour s’approcher de l’idéal de l’égalité des chances scolaires. Cependant, on ne peut pas ignorer que cet idéal a conduit, en France notamment, à établir un clivage entre les vainqueurs et les vaincus de la compétition méritocratique, et à confier à l’école le monopole de la définition du mérite des individus. Ce clivage se retourne contre l’école elle-même et contre la démocratie. Peut-être faudrait-il ne pas tout attendre de l’école et de la forme scolaire. Peut-être faudrait-il admettre que le mérite scolaire n’est pas le seul mérite et que les derniers de cordée ne sont pas moins utiles à la vie sociale que les premiers de la classe. Pour cela, encore faudrait-il qu’il existe une volonté politique.
Le point de vue de François Dubet, sociologue, pour l’Observatoire des Inégalités
Dernier ouvrage paru : L’emprise scolaire, avec Marie Duru-Bellat, Presses de Sciences Po, août 2024.
[1] Quand c’est la naissance au sein d’un groupe social qui détermine votre avenir, par exemple le cas des castes en Inde.
[2] Cet indice, calculé par le ministère de l’Éducation, mesure le niveau social moyen des parents d’élèves.
[3] Les sociétés et leur école, François Dubet, Marie Duru-Bellat, Antoine Vérétout, Seuil, 2010.
 MANCHE
MANCHE