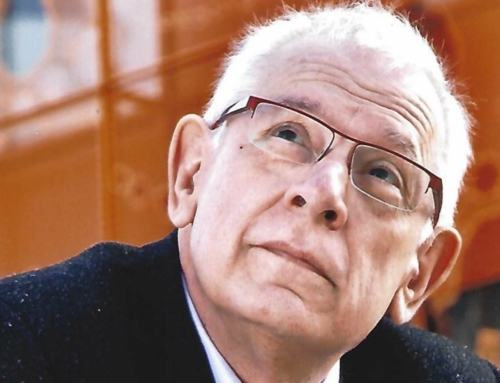Par Paul Devin, président de l’Institut de Recherches de la FSU
De la responsabilité politique des inégalités
Le rapport publié par la Cour des Comptes sur les inégalités entre les femmes et les hommes vient confirmer ce que l’analyse syndicale affirme depuis longtemps.
Il résume clairement la situation actuelle : « Les inégalités entre les femmes et les hommes de l’école au marché du travail se résument en un paradoxe : plus diplômées que les hommes, les femmes n’accèdent pourtant pas aux postes et aux métiers les mieux considérés et les plus rémunérateurs ». Pour la Cour des Comptes, ce constat s’explique par « un portage politique en trompe-l’œil et d’un pilotage interministériel défaillant »… On ne peut pas dénoncer plus clairement la responsabilité politique de ces inégalités.
Sur le plan scolaire, auquel il donne une part importante, le rapport souligne la persistance des stéréotypes qui pèsent sur les représentations et entravent l’accès des filles à certaines disciplines, les mathématiques en particulier. La réforme de 2018, dont les organisations syndicales avaient alerté des effets pernicieux, a renforcé les effets de ces stéréotypes. Mais les inégalités ne concernent pas seulement les choix d’orientation mais aussi les plus faibles chances d’obtention d’un emploi, la moindre reconnaissance salariale et la plus grande difficulté des conditions de travail … les femmes sont discriminées sur tous les plans.
La part de l’éducation
L’éducation a une part majeure de responsabilité dans la persistance des dominations patriarcales dans le monde du travail comme dans l’ensemble de la vie sociale. La multiplication des actions engagées par le ministère de l’Éducation nationale semble légitimer une volonté politique égalitaire mais son absence d’effets témoigne de son insuffisance voire de sa nature gesticulatoire et rhétorique…
Il ne s’agit pas seulement de faire naître chez les élèves une prise de conscience superficielle des inégalités dont on ne déplorerait que partiellement les effets mais de leur donner, dès le plus jeune âge, les savoirs nécessaires pour déconstruire les raisons qui fondent ces inégalités: différenciation genrée des rôles sociaux, stéréotypes qui attribuent des qualités ou des aptitudes spécifiques au genre, construction de la sexualité en fonction de rôles genrés… L’assignation de rôles sociaux n’est pas le seul produit de l’éducation familiale, elle se construit à l’école, au collège, au lycée où il serait essentiel de la déconstruire.
Perdurent des manuels scolaires où, malgré quelques évolutions, la place des femmes reste minorée que ce soit dans le choix des biographies historiques, des extraits littéraires et même dans les exemples concrets cités dans les manuels de mathématiques !
Au quotidien de la vie scolaire, persistent des discours, dont les effets sont parfois invisibiles pour ceux qui les produisent, qui renforcent les rôles, confirment les représentations inégalitaires et légitiment les dominations
Le Code de l’Education affirme pourtant l’objectif d’enseigner, à tous les stades de la scolarité, « l’égalité entre les hommes et les femmes, la lutte contre les préjugés sexistes et la lutte contre les violences faites aux femmes et les violences commises au sein du couple » mais la formation professionnelle nécessaire pour aider les enseignants à traduire cette volonté dans les pratiques quotidiennes reste des plus timide.
L’enjeu n’est pas seulement de financer quelques campagnes d’affiches, de construire quelques outils, si nécessaires soient-ils, l’enjeu est d’incorporer cet enseignement à l’égalité et contre les violences dans l’ensemble des pratiques scolaires, sur le plan des contenus enseignés, comme sur celui de la régulation de la vie scolaire.
Un tel enseignement doit être pensé dans les termes d’une lutte c’est-à-dire à la fois par une mobilisation de l’ensemble des acteurs et dans la perspective de l’effectivité de ses résultats.
Car nous pourrions avoir l’impression d’une évolution générale rassurante et d’une résistance qui se confinerait dans les agissements de l’extrême-droite. Mais les rapports du Haut Conseil à l’Égalité entre les femmes et les hommes[1] (HCE) attestent non seulement de la persistance du sexisme mais alertent de son aggravation. La prise de conscience nous laisserait penser que la tolérance vis-à vis des idées et des actes sexistes s’est amoindrie mais l’analyse de la réalité montre qu’il n’en est rien.
Le « baromètre sexisme[2] » du même HCE montre comment l’école est un « incubateur du sexisme » en laissant perdurer ses manifestations.
Éduquer à la vie affective, relationnelle et sexuelle
La mise en œuvre des programmes d’enseignement de la vie affective, relationnelle et sexuelle (EVARS) doit permettre d’accentuer la mobilisation des enseignants.
La décision ministérielle, concédée aux pressions réactionnaires de l’extrême-droite, que les questions liées à la sexualité ne soient pas abordées au premier degré est un non-sens. Si une adaptation à l’âge des enfants est une absolue nécessité de leur respect, cela ne peut se confondre avec une exclusion de la question.
D’abord parce qu’elle relève d’une curiosité de l’enfant qui ne peut être laissée seule face aux contenus médiatiques auxquels il peut avoir accès et à la difficulté que des parents peuvent rencontrer pour y répondre.
Mais ensuite parce que c’est dans la question sexuelle que se construisent bien des stéréotypes. Il suffit d’écouter les discussions de cour de récréation pour s’en convaincre. Les enseignant·es sont de plus en plus fréquemment confronté·es à des comportements d’élèves de nature sexuelle qui nient le consentement de l’autre. La consigne ministérielle devrait-elle leur faire considérer qu’il n’est pas de leur responsabilité de traiter ces questions de sexualité ?
Enfin parce que la reproduction et la sexualité humaine étant au programme de sciences du cycle 3, il ne peut être concevable de les limiter à leur dimensions physiologiques sans interroger leur inscription sociale.
Néanmoins l’EVARS doit être considérée comme une opportunité de se saisir de la question de l’éducation à l’égalité et contre les violences. Au-delà de l’existence du programme, c’est à sa mise en œuvre qu’il faut maintenant s’atteler. Cela demande qu’une formation ambitieuse soit menée qui permette aux enseignant·es de disposer des savoirs professionnels nécessaires pour déconstruire les stéréotypes et donner à nos élèves toutes les ressources qui les engageront dans leurs propres vies à renoncer aux violences sexistes et sexuelles et à devenir les acteurs de la transformation sociale que nous devons réussir pour parvenir à une égalité réelle. Il en va de la perspective émancipatrice de l’école.
[1] Haut Conseil à l’égalité entre les femmes et les hommes, Rapport annuel 2024 sur l’état des lieux du sexisme en France
[2] ViaVoice, HCE, Baromètre sexisme, vague 3, janvier 2024
 MANCHE
MANCHE