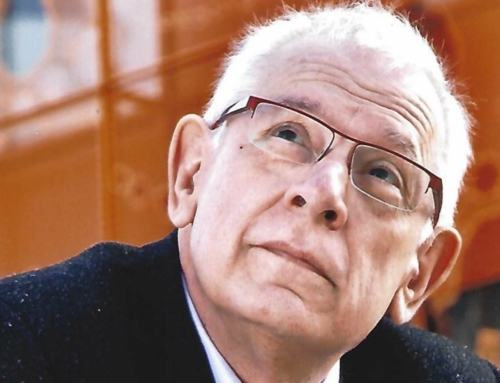Le souvenir d’un ministre de l’Education nationale humaniste et enclin au dialogue ne doit pas nous faire oublier les visions très libérales de François Bayrou dont le projet est en réalité de soumettre le service public d’éducation aux initiatives individuelles et locales pour le livrer aux principes concurrentiels du marché.
 Échaudé par l’ampleur des mobilisations qui lui firent renoncer à modifier la loi Falloux, François Bayrou fut à partir de janvier 1994, un ministre attentif à éviter tout nouveau conflit majeur avec les organisations syndicales. D’où le souvenir d’un ministre de dialogue social dont certains syndicalistes disent même qu’il fut un « bon ministre ».
Échaudé par l’ampleur des mobilisations qui lui firent renoncer à modifier la loi Falloux, François Bayrou fut à partir de janvier 1994, un ministre attentif à éviter tout nouveau conflit majeur avec les organisations syndicales. D’où le souvenir d’un ministre de dialogue social dont certains syndicalistes disent même qu’il fut un « bon ministre ».
Mais cette stratégie politique conciliante doit-elle nous faire oublier ce qu’étaient ses visions de transformation du service public d’éducation ?
Ministre de l’Education nationale de la cohabitation (30 mars 1993-2 juin 1997)
Suite aux élections législatives des 21 et 28 mars 1993 qui ont donné une large majorité à la droite, François Mitterrand (PS) a nommé Édouard Balladur (RPR) comme premier ministre. François Bayrou devient ministre de l’Education nationale.
La période est celle d’une profonde restructuration du syndicalisme enseignant, suite à l’éclatement de la FEN. Lorsque François Bayrou devient ministre, la FSU n’a pas encore tenu la conférence de presse qui allait annoncer sa naissance, deux semaines plus tard, le 14 avril 1993.
Financer l’école privée
Des pressions de l’enseignement privé vers le projet de loi
Depuis l’échec de la loi Savary[1], les pressions de l’UNAPEL[2] n’avaient cessé d’exiger une revalorisation du forfait d’externat[3], la fin les limitations financières de la loi Falloux[4] et l’alignement des conditions d’exercice des enseignants privés sur ceux du public[5].
En 1992, les accords Cloupet-Lang[6] permettaient un rattrapage des forfaits d’externat, attribuaient des décharges aux directeurs d’école et finançaient la formation des enseignants privés… Mais le subventionnement public des investissements de l’enseignement privé restait limité par les principes de la loi Falloux[7] : 10% des dépenses annuelles de l’établissement pour le second degré et rien pour les écoles primaires.
A peine arrivé au ministère de l’Education nationale[8], François Bayrou prépare un projet de loi destiné à faire sauter cette limitation tout en essayant de rassurer en prétendant la faible portée effective du texte.
La loi présentée par le député Bruno Bourg-Broc est adoptée à l’Assemblée nationale en première lecture le 28 juin 1993. François Mitterrand, inquiet des effets de conflits d’une telle loi, refuse de l’inscrire à l’ordre du jour de la session extraordinaire. Elle n’est présentée au Sénat qu’en décembre. Pour nouvel argument, le rapport du doyen Vedel souligne la vétusté des locaux des écoles privées. Il est publié[9] quelques jours avant le vote de la loi, le 15 décembre 1993.
Au-delà du refus d’une libre augmentation du financement de l’école privée par les collectivités territoriales, les opposants à la loi dénoncent une méthode sans consultation, ni négociation. Profitant du rapport de force parlementaire et trompant l’opinion sur l’impact réel de la loi, François Bayrou tente de passer en force … les syndicats vont l’empêcher de le faire.
La manifestation du 17 décembre 1993
Une manifestation est organisée le 17 décembre 1993, deux jours après le vote de la loi par le Sénat. Malgré les délais très courts, le succès du 17 décembre est grand : même les chiffres officiels font état d’une grève massive (60% dans le premier degré, 45% dans le second degré). En un temps très court, les organisations syndicales ont réussi à réunir plus de 20000 personnes à Paris. En province, ce sont plus de 50 000 manifestants qui se sont rassemblées dans une soixantaine de villes. La mobilisation a été particulièrement forte dans les départements où l’enseignement privé est bien implanté : en Haute-Loire et surtout en Bretagne où le nombre de grévistes ont atteint 80% dans certaines villes.
La présence massive de la FSU, dont un grand nombre d’institutrices et instituteurs du jeune SNUipp, n’échappe pas à l’observation des journalistes qui remarquent que « leur supériorité était écrasante sur une FEN reléguée en queue de cortège […] et sur les maigres troupes du Syndicat des enseignants (SE-FEN)[10] ». Même Jean-Claude Barbarant, secrétaire général du SE-FEN en convient !
La manifestation du 16 janvier 1994 et l’échec de Bayrou
L’appel à une seconde journée en janvier est immédiatement lancé par le CNAL et les syndicats enseignants. Il connaît un immense succès : c’est un million de manifestants qui défile à Paris. L’affluence est telle que bien des participants passeront leur temps sur place, jusqu’à la nuit, sans même pouvoir démarrer.
Le 13 janvier, quelques jours avant la manifestation, le Conseil constitutionnel avait retoqué l’article 2 de la loi qui autorisait un subventionnement du privé à la libre administration des collectivités territoriales. Le motif du rejet est celui de l’inégalité produite par une telle liberté.
Bayrou doit concéder à la promulgation d’une loi qui, sans son article 2, n’a plus guère d’effets et perd son objectif financier en faveur de l’école privée.
C’est au nom de l’égalité qu’il défendait la révision de la loi Falloux, c’est au nom de l’égalité que le Conseil constitutionnel s’y oppose.
L’alliance du public et du privé
Dans ses interventions tout au long de l’année 1993, Bayrou affiche une conception des plus favorables à l’école privée, considérant que « l’humanisme chrétien et l’humanisme laïque devront s’allier[11] », niant l’existence d’une concurrence entre privé et public[12] et voulant amoindrir les effets de sa loi : « Personne n’est lésé dans cette affaire et surtout pas l’école publique… Il y a une énorme disproportion entre les vagues qui sont faites et la réalité[13] ».
La logique annoncée est celle d’une stricte égalité entre public et privé et c’est à ce titre de Bayrou défend devant le Sénat une généreuse mise en application des accords Cloupet-Lang d’autant qu’il peut le faire en s’inscrivant dans la logique voulue par le gouvernement socialiste.
 Privatiser l’enseignement public ?
Privatiser l’enseignement public ?
Sous un discours que beaucoup veulent entendre comme témoignant seulement d’une propension humaniste chrétienne, Bayrou a un autre projet. Dans un ouvrage publié en 1990[14], il a exposé son projet de réforme « magistrale » où il affirme que l’avenir de l’école repose sur les enseignants et non sur l’organisation institutionnelle. Le propos pourrait paraître relever de la seule estime du corps enseignant mais il vise, en réalité, à prôner l’initiative individuelle comme moyen de soustraire l’institution de son emprise étatique, jugée comme « le conservatoire des hiérarchies figées[15] ». La dénonciation d’un État défaillant, argumentée par le constat des inégalités scolaires, n’est en réalité que l’argument d’une vision très libérale du service public.
L’alignement des principes de financement du privé sur le public voulu par François Bayrou n’était donc pas seulement un généreux cadeau aux établissements catholiques. Il ouvrait aussi la perspective d’une transformation de l’enseignement public à laquelle aspirait François Bayrou : égalité de financement, égalité d’autonomie. Il s’agissait de donner aux établissements privés les libertés financières du financement public et de donner aux établissements publics les libertés d’autonomie du privé !
Dès les premiers jours du ministère Bayrou, est nommé à la tête du cabinet un énarque de 45 ans : Guy Bourgeois. Ancien secrétaire général dans les académies de Paris puis de Versailles, collaborateur proche des ministres de l’Éducation Christian Beullac et René Monory, Guy Bourgeois a fondé en février 1993, avec le philosophe Philippe Nemo, l’association « Les créateurs d‘école » qui défend un système éducatif déconcentré et concurrentiel, capable de mettre fin à une situation « soviétiforme » où les organisations syndicales auraient imposé leur visées marxistes. Dans la liste des membres de l’association, Xavier Darcos alors inspecteur général.
L’harmonisation des conditions financières entre public et privé apparaît alors comme une condition nécessaires pour aller vers un système éducatif reposant essentiellement sur les initiatives individuelles financées par le chèque éducation. Dans son premier bulletin, l’association « Les créateurs d‘école » annonce sa stratégie : « l’identification des verrous et les moyens de les faire sauter. Ce sera sans doute la partie la plus délicate de notre travail car il ne nous faudra pas tomber dans le piège de la réforme globale… la solution réside sans doute dans la mise en œuvre de dispositifs dérogatoires[16] ». Face à une conception nationale du service public d’éducation, elle défend l’initiative locale qui permettra une transformation radicale mais discrète.
Hiérarchie et ressources humaines
Là où certains soumettent cette autonomie au renforcement du pouvoir hiérarchique local, les « créateurs d’école » misent sur la responsabilité et l’initiative. Un discours que partage largement François Bayrou qui ne veut pas centrer l’autonomie sur l’augmentation du pouvoir hiérarchique : « Si l’enseignant n’a pas le sentiment de sa responsabilité dans sa classes, s’il n’est pas animé par une profonde envie de réussir, vous pourrez mettre au-dessus de lui tous les chefs que vous voudrez, vous n’arriverez pas à changer quoi que ce soit[17] ». L’idée est plutôt de jouer la mise en concurrence des personnels.
La perspective de réforme de la gestion des ressources humaines énoncée par François Bayrou s’exprime dans un discours d’attention à la condition enseignante. Ainsi affirme-t-il vouloir « rompre avec l’habitude détestable qui consiste à considérer les enseignants comme des pions qui peuvent être déplacés à loisir [18]». Mais en réalité l’enjeu est celui d’une gestion managériale des personnels : « détecter les réussites » dit-il pour justifier une gestion au mérite, fondée sur le profilage des postes[19]. Le discours est habile, évitant scrupuleusement toute allusion statutaire et insistant sur la nécessité de protéger la nomination de jeunes enseignants dans les zones les plus difficiles.
L’affirmation de la place centrale de l’enseignant et de la nécessaire liberté de ses initiatives s’inscrit dans une conception ultra-libérale de l’exercice professionnel : « Je l’ai dit souvent, l’enseignant exerce une profession libérale au plein sens du terme[20]». Et si la réforme idéale de François Bayrou est à l’échelle de la classe et non du système, ce n’est pas tant par priorité pédagogique que parce que cette échelle est celle de la plus radicale rupture avec une conception étatique du service public et qu’elle peut se jouer « à bas bruit ».
 Réformer l’école
Réformer l’école
Dès janvier 1994, François Bayrou propose aux organisations syndicales une concertation sur l’avenir du système éducatif[21], cherchant à renouer avec elles et tout particulièrement avec les syndicats enseignants de la FSU, compte-tenu de la donne nouvelle des élections professionnelles de décembre 1993 qui lui a donné la première place dans les organisations syndicales enseignantes[22].
Réformer sans moyens
Tout au long des rencontres qui s’échelonneront de janvier à mai 1994, les syndicats affirment la nécessité de nourrir la réforme par des crédits et des postes. Michel Deschamps, secrétaire général de la FSU, réclame une loi de programmation. Le ministre écoute et lance quelques pistes qui prennent garde de ne pas aborder les questions statutaires et de reléguer la question des moyens d’autant que Nicolas Sarkozy, ministre du budget, ne cesse de répéter qu’il n’y aura pas d’augmentation budgétaire.
Le 9 mai 1994, le ministre annonce 155 propositions. Elles insistent sur la lutte contre les difficultés scolaires avec des effectifs réduits en sixième pour les élèves nécessitant une remise à niveau et un renforcement de l’enseignement du français. Mais l’incertitude reste grande quant aux moyens qui y seront consacrés. Aussi, au CSE du 8 novembre 1994, constatant que le budget voté en octobre reste largement insuffisant pour mettre en œuvre les ambitions du « nouveau contrat pour l’école », les organisations syndicales émettent un vote majoritairement négatif.
Le premier ministre ayant voulu inscrire le « nouveau contrat pour l’école » dans la loi, l’Assemblée en examine le texte les 21 et 22 décembres 1994 ; le Sénat, les 4 et 5 juillet 1995. La loi est adoptée le 5 juillet 1995. Nombreux sont ceux, dans l’opposition, qui constatent alors la disproportion entre la prétention de cette loi de programmation et les moyens dont dispose sa mise en œuvre. Face au débat sur l’importance des moyens, Bayrou tente de renvoyer dos à dos la droite qui dit « on veut des chefs » et la gauche qui dit « on veut des moyens » en proposant une alternative « je vous donne des responsabilités ». La formule, déjà présente dans son livre de 1990 lui plaît et il la répétera souvent … l’idée d’une autonomie des établissements qui viendrait compenser le déficit des moyens en se basant sur la responsabilité des agents et non sur le pouvoir hiérarchique. C’est dans cette perspective qu’il veut réformer la gestion des ressources humaines.
Sur le collège unique qu’il avait fustigé quelques années auparavant (« collège unique, collège inique »), Bayrou tient désormais un discours plus modéré : « La création du collège unique au milieu des années soixante-dix a constitué un progrès. […] Mais une dérive s’est produite. On est passé du collège unique à un collège uniforme qui n’a pas permis de répondre réellement à l’hétérogénéité des élèves[23] » Pour y remédier François Bayrou défend des classes de 6ème de « remise à flot »[24]. La commission présidée par l’inspecteur général Alain Bouchez donne lieu à un Livre blanc[25] qui prévoit « un socle fondamental de connaissances » et une orientation possible dès la fin de la sixième vers une classe adaptée de deux ans précédant une orientation vers un quatrième technologique ou une classe en alternance (CIPA) en collège ou en lycée professionnel. Le tout dans une large souplesse de gestion à l’échelle de l’établissement, notamment au niveau des horaires d’enseignement. L’expérimentation est généralisée dès la rentrée 1995.
François Bayrou défend aussi la mise en concurrence des lycées professionnels et de l’apprentissage. Il utilise le même argument qu’avec l’école privée, celui d’une nécessaire collaboration du public et du privé : « notre action doit aller dans le sens de la réconciliation entre l’éducation nationale et l’apprentissage[26] ». Et c’est au prétexte de la fin de la concurrence, qu’il ouvre les voies d’une concurrence plus vive encore ! Il faut dire que Dominique de Calan, numéro deux de l’Union des industries et métiers de la métallurgie[27] a des liens étroits avec l’association des « créateurs d’école » et œuvre pour que la formation professionnelle soit pensée dans le giron patronal.
La finalité du projet de Bayrou est celle d’une individualisation des parcours censée mettre fin à l’uniformité du collège. Le discours insiste sur une différenciation positive, fondée sur « les domaines d’excellence des élèves » mais en réalité le jeu des options produit une hiérarchisation du fait de leur usage averti par les familles les plus favorisées. Le collège de Bayrou est celui d’une orientation précoce et d’un raccourcissement des études pour ceux à qui l’ambition de l’école se limitera à « un socle fondamental de connaissances ».
[1] Loi qui avait visé, dans les premières années de la mandature de Mitterrand (1982-1984) la création d’un « service public unifié et laïque de l’éducation nationale » (SPULEN)
[2] Union nationale des associations de parents de l’enseignement libre
[3] Financement public du fonctionnement des établissements privés prévu par la loi Debré en plus de la rémunération des enseignants.
[4] La Loi Falloux (1850) plafonnait les investissements publics pour les bâtiments scolaires des établissements privés de second degré à 10%.
[5] Décharges de direction, formation
[6] Accords Cloupet-Lang du nom du secrétaire général de l’Enseignement catholique (Max Cloupet) et du ministre de l’Éducation nationale (Jack Lang)
[7] Loi relative à l’enseignement du 15 mars 1850, article 69
[8] Assemblée nationale, 21 avril 1993
[9] Le Monde, 12 janvier 1994
[10] Le Monde, 20 décembre 1993
[11] L’Humanité, 10 janvier 1994
[12] Le Monde, 11 janvier 1994
[13] France2, L’heure de vérité, 9 janvier 1994
[14] François BAYROU, 1990-2000, la décennie des mal-appris, 1990, Flammarion
[15] François BAYROU, 1990-2000, la décennie des mal-appris, 1990, Flammarion, p.64
[16] Créateurs d’école, Les verrous à faire sauter,
[17] Sénat, séance du 6 décembre 1993, p.5654
[18] Sénat, séance du 6 décembre 1993, p.5628
[19] Le Monde, 7 septembre 1993, 15 janvier 1994, 10 mai 1994 et L’Humanité, 10 mai 1994
[20] Sénat, séance du 6 décembre 1993, p.5654
[21] « Grand débat national sur l’avenir du système éducatif »
[22] 40,2% des voix contre 21,9% pour la FEN
[23] Sénat, séance du 6 décembre 1993, p.5627
[24] Le Monde, 15 janvier 1994
[25] Livre blanc des collèges, 17 janvier 1994
[26] Sénat, 26 juin 1996, réponse à la question 0423S, p.4180
[27] UIMM, fédération patronale française de la métallurgie. C’est l’héritière du « comité des forges ».
 MANCHE
MANCHE