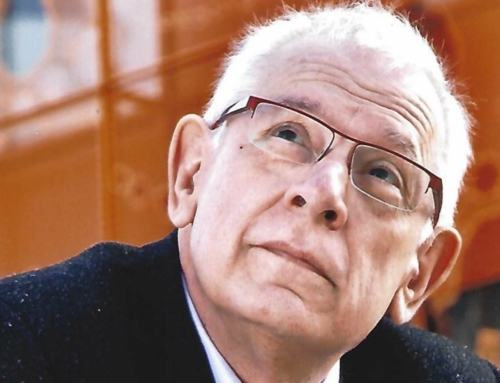4000 postes supprimés pour 2026 ! La présentation du budget de l’Éducation nationale révèle avant tout des choix politiques, plus qu’un véritable débat sur les moyens ou sur l’avenir du pays. À se demander au regard des comparaisons internationales et des enjeux d’avenir si un autre choix ne serait pas non seulement possible, mais nécessaire. Face à la baisse démographique, une question s’impose : faut-il supprimer des postes ou réduire la taille des classes et redéployer des moyens pour l’inclusion et la formation ? Cette question démocratique reste rhétorique et théorique, et est tranchée par la réponse politique. Pour Amélie de Montchalin, ministre de l’Action et des Comptes publics, la France a davantage besoin de militaires, de gendarmes et de policiers que d’enseignants. Le PLF 2026 voit un changement historique, symbolique et programmatique : le budget de l’armée avec 68,4 milliards (+6,7) dépasse celui de l’Éducation nationale (64,5 milliards d’euros).
Des chiffres en trompe-l’œil
Selon un travail de l’Institut des Politiques Publiques (IPP), le gouvernement use d’un stratagème comptable consistant à intégrer dans le budget de l’Éducation nationale la contribution aux pensions ce qui gonfle artificiellement les chiffres. Ainsi, en 2023, le budget global de l’Éducation nationale a été majoré de plus de 10 milliards d’euros sur un total de 81 milliards, et la dépense intérieure d’éducation (celle retenue par l’OCDE pour les comparaisons internationales) d’environ 15 milliards d’euros.
Selon l’économiste Julien Grenet, « le budget de l’Éducation nationale est artificiellement gonflé ». En apparence, la France semble dépensière, mais une fois les retraites retirées du calcul, elle investit moins que la moyenne européenne et de l’OCDE, notamment dans le primaire.
Des classes plus chargées, des professeurs moins formés et reconnus
Alors que la démographie scolaire baisse, le gouvernement choisit de supprimer des postes plutôt que d’améliorer le taux d’encadrement et les conditions d’apprentissage. Ce sont plus de 100 000 élèves en moins à la rentrée 2026, mais la France continue d’avoir les classes les plus chargées selon l’OCDE. Le tour d’horizon sur la question du métier de professeur dans le dernier rapport pointait des professeurs plus âgés avec plus d’élèves, moins bien payés, avec un milieu de carrière oublié avec des salaires inférieurs de 14% à la moyenne des pays, plus de contractuels dans le second degré avec 9,1% contre 7,1 en moyenne.
L’enquête internationale Talis publiée en octobre souligne l’insuffisance, voire le retard de la formation initiale comme continue. Alors que les enseignants français sont de plus en plus confrontés à des défis pédagogiques, technologiques et sociaux, les formations initiales comme continues peinent à les préparer et les accompagner. Une complexité croissante du métier, sans outils pour y faire face. Un exemple : la diversité des élèves s’intensifie, en particulier dans le contexte de l’école inclusive. Ainsi près de 3/4 des enseignants français exercent désormais dans des établissements où plus de 10 % des élèves ont des besoins éducatifs particuliers.
La logique budgétaire se traduit par une austérité persistante : gel du point d’indice, crise d’attractivité du métier, conditions de travail dégradées et déclassement salarial des enseignants. L’école publique subit des pressions multiples qui affaiblissent durablement le système éducatif, au détriment des élèves comme des personnels.
Des suppressions de postes maquillées
Le budget 2026 prévoit la création de 5 440 postes, liés à la réforme du recrutement et de la formation initiale des enseignants. La réforme bascule le concours durant le bac+3 et non plus bac+5. Les étudiants seront élèves puis fonctionnaire stagiaires. Mais derrière cette annonce se cachent en réalité 4 600 suppressions nettes de postes, selon Les Échos.
4 018 postes disparaissent : 2 373 dans le premier degré, 1 645 dans le second degré.
L’an passé, la ministre Borne avait pourtant « sauvé » 4 000 postes initialement menacés : le budget 2026 serait donc pire que celui de 2025, malgré la communication d’une hausse de 200 millions d’euros sur les 64,4 milliards alloués. Le rapporteur de la commission des finances du Sénat, Oliver Paccaud (LR) propose de doubler les suppressions de postes pour atteindre 8000 ETP. Il justifie ce choix par la baisse démographique et par la volonté de revaloriser les rémunérations des enseignants.
42 000 élèves toujours en attente d’AESH
La situation n’est guère meilleure pour les accompagnants d’élèves en situation de handicap (AESH). Malgré la hausse des besoins, le budget 2026 ralentit le rythme des créations : seulement 1 200 postes prévus, contre 2 000 en 2025 et 3 000 en 2024. Ce sont plus de 350 000 enfants qui ont droit à une AESH, 50 000 n’en avaient pas à la rentrée 2025. A la veille des vacances de la Toussaint, ils étaient 42 000 sans soutien adapté. Aucune création n’est non plus prévue pour les pôles d’appui à la scolarité (PAS).
Résultat : une politique affichant une volonté d’inclusion, mais sans moyens suffisants pour la mettre en œuvre.
Un choix politique, pas une fatalité
Plus qu’un problème de budget, c’est bien un choix politique. Comme le soulignent les économistes Julien Grenet et Camille Landais dans une note publiée le 14 mai 2025, la baisse démographique devrait être une opportunité pour repenser les priorités éducatives, et non un prétexte pour réduire les moyens.
Ils plaident pour une réorientation de la dépense éducative : investir là où son efficacité est prouvée — réduction de la taille des classes dans le primaire, formation continue ciblée et accompagnée — plutôt que d’entretenir la logique de contraction budgétaire.
Car investir dans l’éducation, rappellent-ils, reste l’un des usages les plus efficaces des finances publiques, à condition que les moyens soient correctement orientés.
Sous couvert de rationalisation budgétaire, dans la logique du New Management Public, le gouvernement fait le choix d’une école à l’économie, au risque d’un affaiblissement durable du service public d’éducation. Les chiffres peuvent être habilement présentés, mais la réalité demeure : moins d’enseignants, toujours pas de remplaçants en cas d’absence, des classes plus chargées, et une inclusion sans moyens.
Or, c’est dans la jeunesse que se joue l’avenir du pays. Et c’est d’abord par le budget de l’Éducation nationale que se mesure la volonté politique de préparer cet avenir.
https://www.cafepedagogique.net/2025/11/03/budget-de-leducation-nationale-des-choix-politiques-au-detriment-de-lecole/
 MANCHE
MANCHE