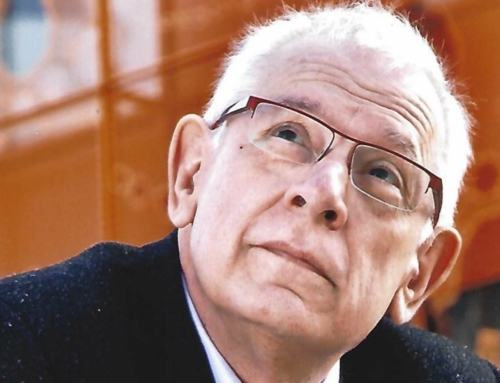Le premier ministre a demandé au Conseil économique, social et environnemental (CESE) d’organiser une convention citoyenne « Comment mieux structurer les différents temps de la vie quotidienne des enfants afin qu’ils soient plus favorables à leurs apprentissages, à leur développement et à leur santé ? ».
La préoccupation est évidemment louable, mais quelles en sont les intentions réelles ?
Tout d’abord, un étonnement consterné : l’absence dans la lettre du premier ministre au CESE[1] de ce qui constitue pourtant l’élément essentiel de l’analyse de l’évolution du temps scolaire : sa forte réduction.
En 1969, en 1989, en 2008, en 2014, les heures hebdomadaires des élèves de l’école primaire ont été diminuées et ont fini par réduire de 20% leur temps scolaire, soit plus de sept semaines chaque année scolaire, c’est-à-dire à peu près une année sur la seule scolarité élémentaire !
On peut arguer d’un changement de contexte, d’une meilleure prise en compte des rythmes de l’enfant, voire d’initiatives périscolaires locales, mais il n’en reste pas moins difficile de croire qu’on pourrait apprendre mieux avec moins d’école quand la perte prend de telles proportions !
Les années de scolarisation au collège ont connu aussi leur part de réduction avec plus de 250 heures annuelles supprimées. Et on pourrait citer aussi le lycée professionnel qui après avoir perdu une année entière lors du passage au bac en trois ans, vient de connaître de nouvelles coupes.
À cela, il faut ajouter les heures de non-remplacement des enseignants en congé maladie ou maternité dont il avait été chiffré qu’ils représentaient, dans les départements les plus touchés par les difficultés de remplacement, la privation d’un an de scolarité obligatoire dans le cursus scolaire de l’élève !
Comment pourrait-on penser la question du temps scolaire dans la perspective de le rendre « plus favorable aux apprentissages » sans considérer cette réduction de temps comme une question majeure ? Bien sûr, la question scolaire n’est pas seulement une question quantitative, mais de là à considérer qu’on pourrait apprendre mieux avec moins d’école ….
Ce tabou de la question quantitative sert la volonté d’ignorer la question des moyens.
Mais il y a une autre conséquence, c’est qu’il désigne les enseignantes et les enseignants comme les principaux responsables du problème au prétexte d’une défense corporatiste de leurs emplois du temps qui nuirait à l’intérêt des élèves. D’ailleurs, à peine l’annonce de la convention citoyenne, une partie de la presse s’y est engouffrée laissant croire par exemple que les vacances d’été françaises seraient parmi les plus longues, ce qui est faux !
Une autre perspective se dessine : recentrer l’école sur les apprentissages fondamentaux pour externaliser une part des enseignements qu’elle assure aujourd’hui, en premier lieu l’EPS et les enseignements artistiques et culturels. L’orientation donnée par la lettre du premier ministre est claire : donner une place majeure aux dispositifs locaux et territoriaux. On sait comment cette externalisation est loin d’avoir fait la preuve d’un renforcement de l’égalité et combien, au contraire, elle est marquée par les écarts de richesse des territoires et leurs volontés particulières.
Au-delà de la question de l’égalité, c’est le rôle de l’école dans la construction d’une culture commune, facteur de cohésion sociale, qui est menacé. C’est aussi la porte ouverte à l’instrumentalisation idéologique de l’école que porteront certains, par exemple en négligeant les EVARS pour leur préférer des projets patrimoniaux réactionnaires.
Enfin, c’est préparer la mise en marché d’une part de l’activité scolaire que des projets locaux délégueront à des acteurs essentiellement guidés par le profit.
Les habiletés du discours tentent de nous faire croire à une volonté de mieux répondre aux besoins individuels des enfants. Mais nous avons désormais l’expérience de l’incapacité de cette individualisation à permettre une meilleure démocratisation.
Entendons-nous bien, il ne s’agit pas ici de nier la nécessité de développer une plus grande attention aux difficultés particulières des élèves y compris en réfléchissant la question de l’organisation temporelle de la classe. Mais les vecteurs essentiels de ce progrès restent l’amélioration des compétences professionnelles des enseignantes et des enseignants, la réduction de la taille des classes, le renoncement à un management autoritariste et de ses diktats méthodologiques et la fin d’une surenchère continue des contenus de programme.
Tous ces paramètres sont absents des indications données par la lettre ministérielle… pour continuer à nous faire croire qu’on pourrait démocratiser l’accès au savoir en diminuant les moyens et le temps de la scolarisation… c’est-à-dire avec moins d’école !
[1] Lettre de saisine du premier ministre au président du CESE, mai 2025
Paul Devin
 MANCHE
MANCHE